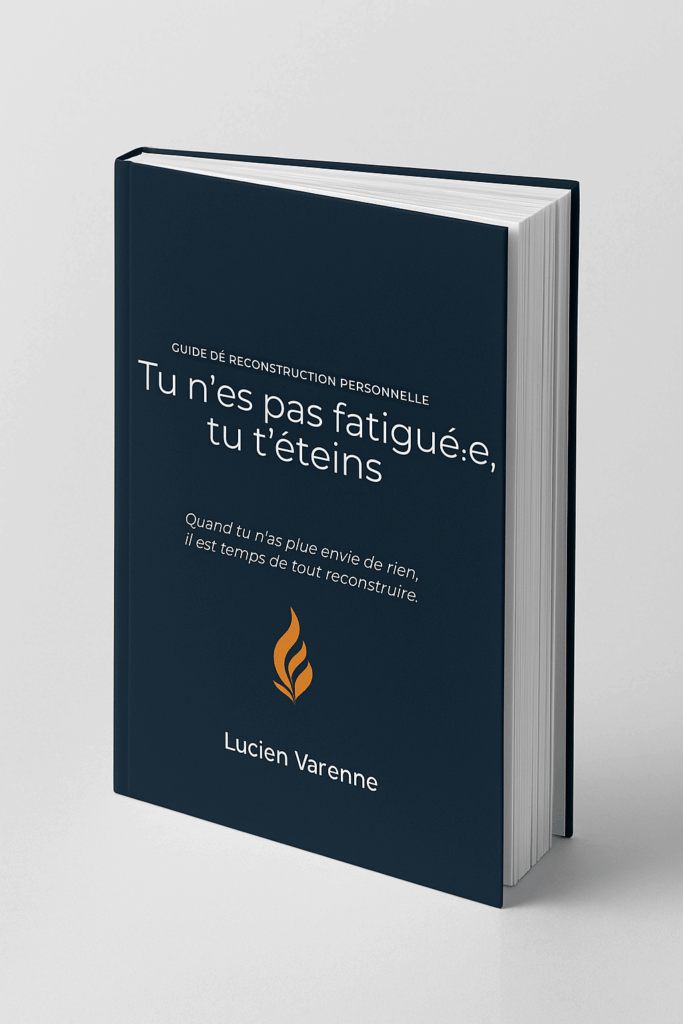L’exclusion professionnelle des personnes concernées par un handicap psychique reste massive
Peut-on encore parler d’un véritable droit au travail lorsque tant de personnes sont laissées sur le bord du chemin ?
Les données sont sans appel. D’après le rapport de l’IGAS (2019-2020), les personnes vivant avec un handicap psychique ont un risque de chômage six à sept fois supérieur à la moyenne. Ce chiffre, à lui seul, interroge la portée réelle des politiques d’inclusion.
Et il ne s’agit pas d’une minorité marginale : selon l’OCDE, un adulte sur cinq en âge de travailler vit avec un trouble mental. Pourtant, le monde du travail continue, dans bien des cas, de les ignorer, de les exclure ou de les rendre invisibles.
Cela, alors même que bon nombre d’entre eux sont compétents, formés, motivés — mais que leur environnement professionnel, lui, ne l’est pas.
Le handicap psychique : un impensé des politiques d’emploi
Quelques chiffres suffisent à illustrer l’ampleur du phénomène :
- Les troubles psychiques représentent le premier motif d’attribution de l’AAH ;
- Ils concernent 25 % des bénéficiaires de l’AAH ;
- Et 59 % des personnes concernées obtiennent une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé).
Ces chiffres confirment deux choses : d’une part, l’ampleur de ce handicap dans la population active, d’autre part, le décalage entre reconnaissance administrative et inclusion professionnelle effective.
Ce qui bloque vraiment : un stigmate social bien ancré
Si le droit est inscrit dans les lois, pourquoi son application concrète est-elle si difficile ?
L’hypothèse centrale défendue ici est claire :
Le principal verrou, ce n’est pas la loi. C’est la représentation sociale du handicap psychique.
Autrement dit : la manière dont la société perçoit (ou redoute) la santé mentale dans le monde du travail.
Ce stigmate agit à plusieurs niveaux, parfois de façon inconsciente :
- Les employeurs qui n’osent pas ;
- Les professionnels de l’insertion qui “n’y croient pas vraiment” ;
- Et les personnes concernées elles-mêmes, qui doutent, s’autocensurent, finissent par se retirer.
Comprendre le stigmate : une blessure invisible mais bien réelle
Le sociologue Erving Goffman, dans son ouvrage fondateur Stigmate (1963), nous rappelle l’origine du mot : chez les Grecs, il désignait une marque d’infamie, gravée dans la chair.
Aujourd’hui, le stigmate n’est plus visible. Mais il laisse des traces :
- Dans les silences gênés en entretien d’embauche,
- Dans les projets professionnels édulcorés,
- Dans les trajectoires systématiquement arrêtées “par précaution”.
Goffman distingue trois types de stigmates :
- Les anomalies physiques ;
- Les “tares du caractère” (où se situe le handicap psychique) ;
- Les stigmates dits “tribaux” (origine, croyance, etc.).
C’est ce deuxième stigmate qui pèse sur les personnes vivant avec un trouble psychique : on ne leur reproche pas ce qu’elles ont, mais ce que la société croit qu’elles sont.
Instables. Irrationnelles. Inemployables.
Le fardeau intérieur : quand le stigmate s’infiltre partout
Le plus insidieux, c’est que ce regard social devient intégré :
Les employeurs évitent, par peur des complications ;Les structures d’accompagnement limitent les ambitions, “par réalisme” ;Les personnes concernées, usées par les refus, finissent par croire qu’elles ne peuvent pas.
Résultat :Le droit est là. Les dispositifs existent.Mais la porte reste fermée, non pas par les textes, mais par les imaginaires.
Travail et santé mentale : un chantier avant tout culturel
Pour rendre effectif ce droit au travail, changer les représentations est devenu indispensable.
- Il ne suffit plus d’ajouter des places : il faut rendre ces places désirables, accessibles, légitimes.
- Il ne suffit plus d’adapter les postes : il faut transformer les conditions de travail, pour tous.
- Il ne suffit plus de parler d’insertion : il faut redonner à chacun le droit d’avoir une trajectoire.
Parce que tant que le regard ne change pas, aucune loi ne pourra suffire.
Et parce que travail et santé mentale doivent enfin cesser d’être des réalités incompatibles.