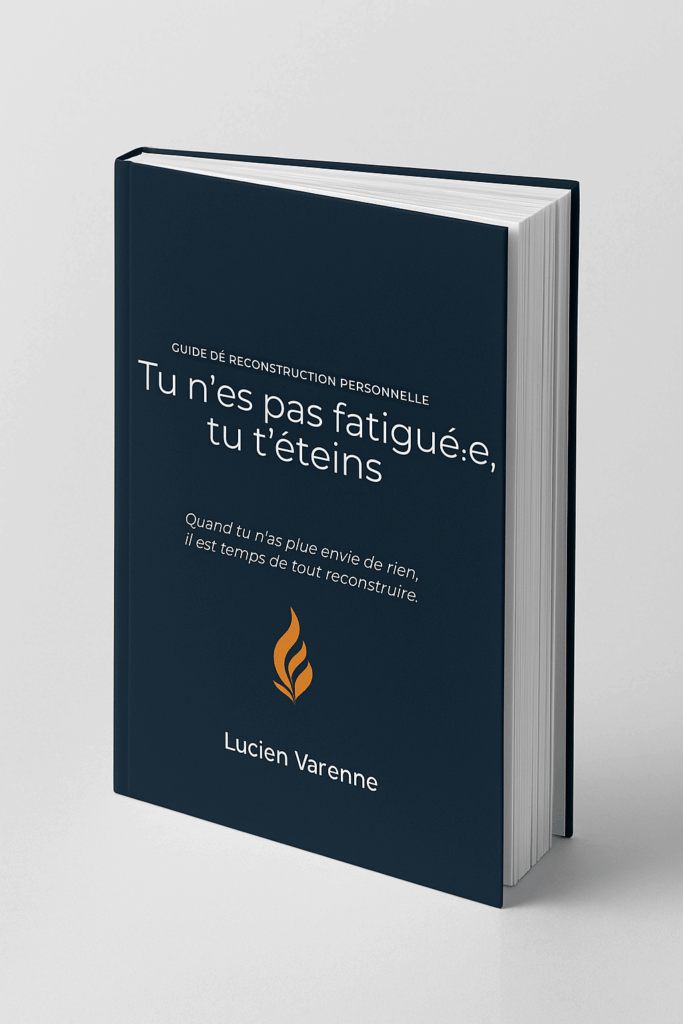Du secteur psychiatrique à la réinsertion professionnelle : quand le soin se déplace dans la vie
Le soin en santé mentale n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a un siècle. Longtemps, on enfermait pour soigner. Aujourd’hui, on soigne pour réinsérer, en plaçant la personne au cœur de son environnement social. C’est ce basculement que raconte l’histoire de la psychiatrie moderne — une histoire à la fois politique, institutionnelle et profondément humaine.
1960 : la naissance du « secteur »
Tout commence avec une circulaire de 1960 qui crée ce que l’on appelle encore aujourd’hui le secteur psychiatrique. Chaque département est découpé en sous-secteurs, rattachés à un hôpital psychiatrique de référence. Mais l’innovation n’est pas géographique : elle est philosophique.
Comme l’explique le psychologue Joseph Mornet, l’idée n’est plus d’isoler le malade dans l’hôpital… mais de déplacer l’hôpital vers la vie du malade.
« Le soin sort de l’asile. Il va à la rencontre de la personne, là où elle vit. »
— Joseph Mornet
Ce changement de paradigme marque le début de la désinstitutionalisation en France, une tendance partagée par de nombreux pays européens sous l’égide de l’OMS.
Mais la France reste prudente : contrairement à l’Italie ou au Royaume-Uni, elle ne ferme pas ses asiles. L’influence des mouvements radicaux comme l’antipsychiatrie, portée notamment par Franco Basaglia, y reste plus marginale.
Pour Basaglia, la folie est d’abord un produit de l’exclusion sociale, et le soin ne peut consister qu’en une réhabilitation économique et communautaire de la personne. Il ira jusqu’à dire :
« Il faut détruire l’hôpital. Le malade doit être soigné sur le lieu de sa souffrance : à la maison, à l’usine, à l’école. »
Moins de lits, plus de territoire
Cette volonté de soigner autrement s’est traduite, au fil des décennies, par une réduction massive du nombre de lits en psychiatrie publique. Un rapport de l’IGAS (2017) révèle que 60 % des lits ont disparu entre 1976 et 2016.
Mais ce sont surtout les lits publics qui ont diminué — tandis que le secteur privé lucratif, lui, progresse.
Ce mouvement s’est accompagné d’un changement de logique dans les politiques publiques : on ne pense plus uniquement en termes d’hospitalisation, mais en termes de territoires de santé, avec une approche globale mêlant soins, prévention et réinsertion.
Réinsertion et emploi : un nouveau défi
Cette logique de désinstitutionalisation a une conséquence directe : les personnes sortent plus vite de l’hôpital, souvent sans accompagnement suffisant, mais toujours dans le but de retrouver une vie sociale ordinaire. Cela suppose — idéalement — de retrouver une activité, si possible professionnelle.
Comme le rappellent les chercheurs Bernard Pachoud et Marc Corbière, l’emploi est devenu un levier essentiel d’insertion pour les personnes en situation de handicap psychique.
« Le raccourcissement des durées d’hospitalisation rend souhaitable la reprise d’une activité professionnelle. »
— Traité de Réhabilitation Psychosociale
Le travail est ici bien plus qu’un revenu. C’est un repère, un moyen de structuration identitaire, un vecteur d’intégration sociale.
Dans la plupart des pays occidentaux, l’insertion professionnelle des personnes souffrant de troubles psychiques persistants — comme la schizophrénie — est même devenue un objectif prioritaire des politiques de santé mentale.
Travailler pour se rétablir, et non l’inverse
Ce que cette évolution traduit, c’est une nouvelle conception du soin.
Soigner ne signifie plus « protéger du monde », mais permettre à la personne de retrouver une place dans la société — avec ses difficultés, ses forces, ses espoirs.
Et dans cette société, le travail reste un pilier fondamental :
👉 Il structure les journées,
👉 Il donne un statut,
👉 Il crée du lien,
👉 Il restaure l’estime de soi.
C’est pourquoi, aujourd’hui, le soin et le travail ne doivent plus être pensés séparément. Ils sont les deux faces d’un même projet : la reconstruction d’un parcours de vie digne et choisi.