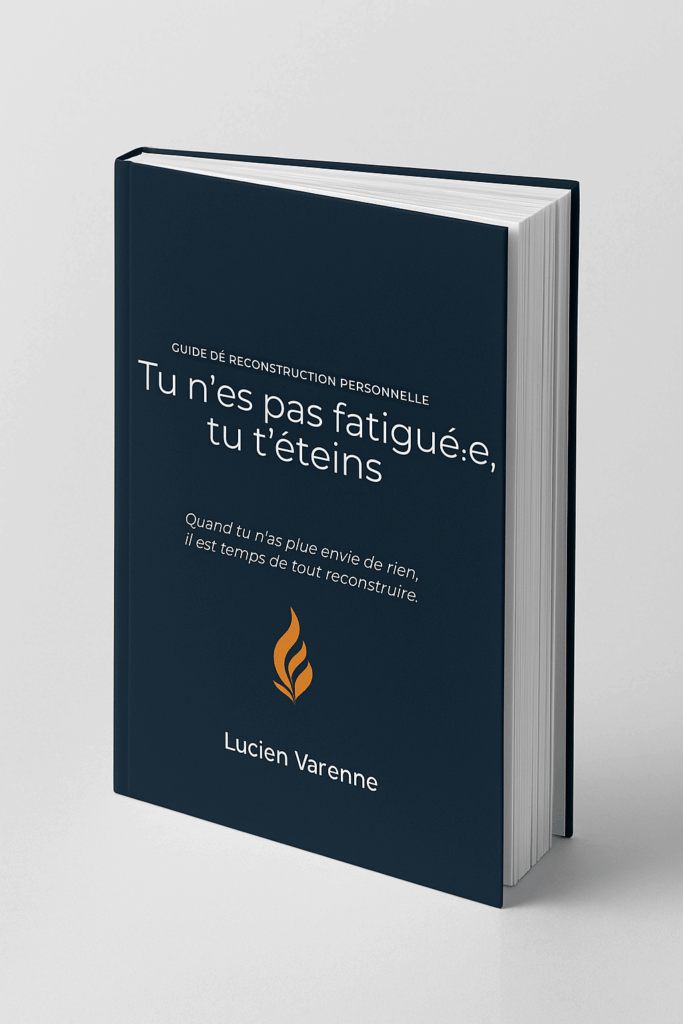On en parle souvent comme d’un slogan : participation. C’est dans les lois, dans les discours officiels, dans les plaquettes d’institutions. Mais derrière ce mot galvaudé, il y a un besoin fondamental, presque vital : celui d’exister pour de vraidans la société.
Quand on parle d’inclusion, notamment pour les personnes en situation de handicap psychique, il ne s’agit pas seulement d’accéder à des droits ou à des soins. Il s’agit de retrouver un pouvoir d’agir, c’est-à-dire de pouvoir peser, contribuer, être reconnu.
Participer, ça veut dire quoi exactement ?
La philosophe Joëlle Zask propose une définition en trois temps qui mérite qu’on s’y attarde :
- Prendre part : être là, être inclus dans un collectif
- Apporter une part : contribuer avec ce qu’on est, ce qu’on sait faire
- Recevoir une part : bénéficier en retour, être reconnu, valorisé
Sans équilibre entre ces trois dimensions, la participation devient un mot creux. Elle se transforme en façade, parfois en simple mascarade. Dans certaines institutions, on donne la parole aux usagers, mais sans leur permettre d’influencer les décisions. Résultat : frustration, désillusion, et impression d’être utilisé.
Zask le dit sans détour : quand participer revient à légitimer un dispositif déjà figé, ce n’est plus de la démocratie. C’est une mise en scène.
Le piège de la fausse participation
Yann Le Bossé, psychosociologue québécois, va encore plus loin. Il rappelle que participer n’est pas une vertu en soi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les collaborateurs participaient aussi – au pire.
Ce qui compte, ce n’est donc pas juste prendre part, mais comment et pour quoi on participe.
Suzan Rifkin a d’ailleurs proposé une échelle des formes de participation, qui va de la simple présence symbolique jusqu’à la co-construction réelle des décisions. Et souvent, on reste en bas de l’échelle.
La participation, levier de puissance personnelle
Mais pourquoi insiste-t-on autant sur ce concept ?
Parce que le fait de pouvoir agir sur son environnement est essentiel à l’équilibre mental. Hannah Arendt l’avait déjà théorisé : seuls ceux qui participent à la régulation du monde social sont réellement des citoyens. Paul Ricœur ajoute une dimension existentielle : notre dignité passe par notre capacité à agir, à être reconnu dans ce que nous faisons.
Si je n’ai pas la possibilité d’avoir un impact, je doute de ma valeur. Et ce doute ronge. Il crée du mal-être, du retrait, du désengagement.
Or, c’est précisément ce que vivent nombre de personnes en situation de handicap psychique. Elles sont là, mais sans prise. On leur parle de soins, rarement de contribution. On les encadre, rarement on les inclut vraiment.
Plus qu’un concept : un besoin vital
C’est pourquoi la participation ne doit pas être pensée comme un simple outil d’animation ou de concertation. C’est un besoin humain fondamental. Participer, c’est se sentir utile. C’est savoir que ce qu’on fait a un poids. C’est ne plus être transparent.
Et dans le champ de la santé mentale, c’est un levier majeur de rétablissement. Car la santé, ce n’est pas juste l’absence de symptôme : c’est la capacité de mener une vie qui a du sens.