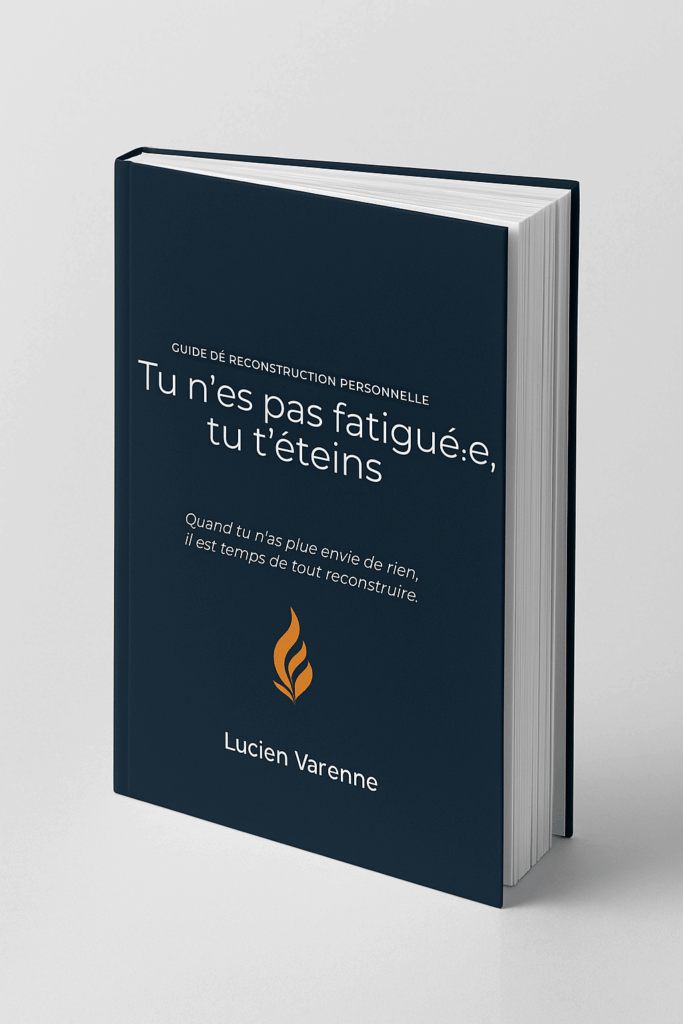Et si notre rapport au travail révélait une tension identitaire profonde ?
En France, le travail est sacré. Il structure nos journées, notre statut social, notre utilité perçue… et pourtant, une majorité de Français rêve d’en faire moins. C’est ce paradoxe qu’ont analysé la sociologue Dominique Méda et la chercheuse Lucie Davoine dans un article marquant de la revue Information sociale.
Travailler, mais pas trop
D’après les enquêtes européennes, près de 70 % des Français considèrent que le travail est « très important » dans leur vie. C’est un record européen. Pourtant, ce sont aussi les plus nombreux à souhaiter que le travail prenne moins de place dans leur quotidien. Un peu comme s’il était à la fois indispensable et envahissant, vital mais épuisant.
Un autre chiffre saisissant : 60 % des Français déclarent qu’ils continueraient à travailler même s’ils n’avaient plus besoin d’argent. Pourquoi ? Parce que le travail, au-delà du salaire, leur donne un sentiment d’utilité, développe leurs capacités, et constitue une source de reconnaissance sociale.
Autrement dit : on travaille pour vivre, mais aussi pour exister aux yeux des autres.
Le travail : repère existentiel en cas d’instabilité
Ce besoin d’existence par le travail devient encore plus fort chez celles et ceux qui en sont privés. Les personnes au chômage ou en emploi précaire associent spontanément le travail au bonheur, comme une condition presque nécessaire pour se sentir bien, utile, légitime. Ce n’est pas qu’une affaire d’argent, mais de place dans la société.
D’où nous vient cette passion française pour le travail ?
Pour comprendre cette relation ambivalente, il faut revenir en arrière. Longtemps, dans l’histoire occidentale, le travail était une affaire de pauvres. Dans la Grèce antique ou sous l’Ancien Régime, l’aristocrate était, par définition, celui qui ne travaillait pas. Travailler, c’était servir, obéir, produire — en bas de l’échelle.
C’est d’abord avec le christianisme qu’un premier tournant s’opère : avec la parabole des talents, l’idée que chacun doit faire fructifier ce qu’il a reçu devient un impératif moral. Le travail, jusque-là réservé aux esclaves et aux serfs, commence à être vu comme une voie de perfection personnelle, même pour les élites religieuses.
Puis vient la modernité, et avec elle, la grande révolution philosophique des Lumières. Des penseurs comme Descartes, Rousseau ou Kant renversent la logique ancienne. Il ne s’agit plus d’un ordre naturel, où chacun est assigné à sa place dans un cosmos hiérarchisé, mais d’un monde où l’individu devient le centre de la réflexion. Le travail devient alors le moyen par lequel l’homme se construit, se cultive, se libère.
L’école républicaine, la morale du travail et l’humanisme moderne
Cette nouvelle vision va s’imposer dans la société grâce à l’école. Comme le rappelle le philosophe Luc Ferry, le “hussard de la République” enseigne aux enfants que c’est par le travail qu’on s’humanise. Travailler, ce n’est plus seulement gagner sa vie, c’est donner du sens à son existence, se rendre utile, progresser.
On retrouve cette idée dans Candide de Voltaire, où un vieux sage dit : « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin. »
Cette transformation culturelle est profonde : elle fait du travail une vertu morale. L’homme moderne ne vaut plus par sa naissance, mais par son activité.
Et si le travail dysfonctionne ?
Mais cette place centrale accordée au travail pose une question vertigineuse : que se passe-t-il quand le travail perd son sens ? Quand il devient source de stress, d’épuisement, ou d’aliénation ? Quand il ne permet plus de se construire, mais de se détruire ?
Aujourd’hui, les risques psychosociaux explosent. Les burn-out, les dépressions liées au travail, ou les « démissions silencieuses » sont les symptômes d’un modèle en crise. Un modèle où le travail continue de structurer la valeur personnelle et sociale des individus… sans leur offrir, en retour, le respect, la reconnaissance ou l’utilité qu’ils en attendent.
Vers une redéfinition ?
On ne sortira pas de ce paradoxe en réduisant simplement le temps de travail. Il faut probablement réinventer le travail lui-même : en lui redonnant du sens, en sortant de la logique de la performance stérile, en renouant avec sa vocation première – participer à quelque chose de plus grand que soi.