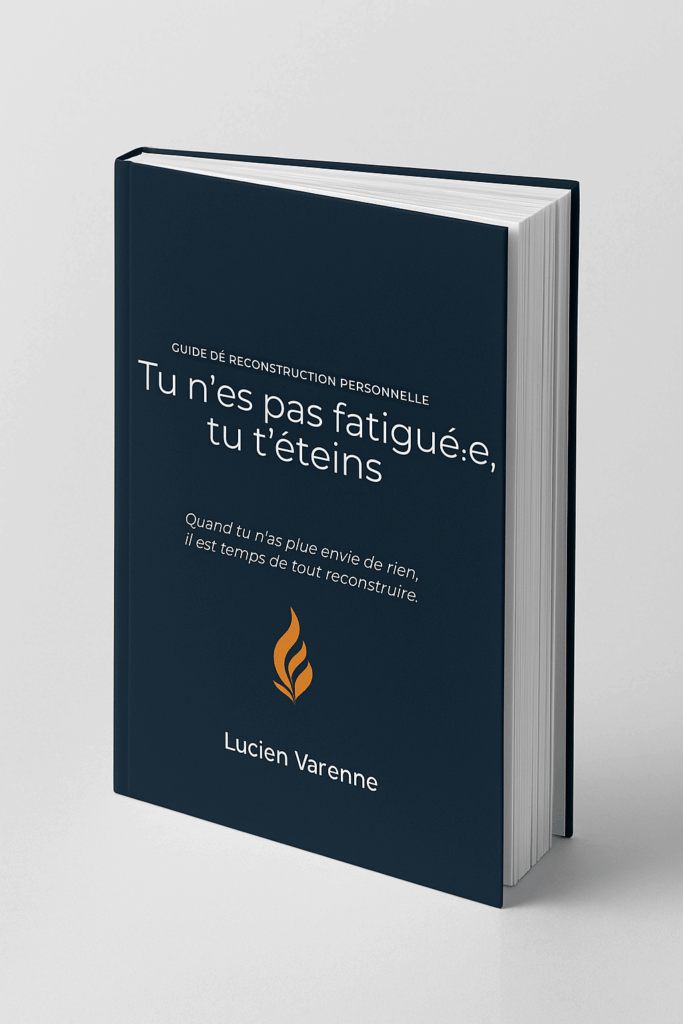On parle beaucoup d’inclusion. On parle aussi de participation. Mais concrètement, où cela se passe-t-il vraiment ? Où observe-t-on des dynamiques capables de transformer à la fois les individus et le collectif ?
Un exemple très éclairant : les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). Ces structures associatives, pensées pour et avec des personnes en situation de handicap psychique, incarnent une forme de démocratie du quotidien. Et surtout : elles fonctionnent.
Une racine politique et soignante
Marielle Valran, docteure en sciences de l’éducation, a mené une enquête ethnographique passionnante sur le fonctionnement d’un GEM. Elle y montre que ces lieux ne tombent pas du ciel : ils s’inscrivent dans une longue histoire, héritée de la psychothérapie institutionnelle (Tosquelles, Oury) et des mouvements critiques de la psychiatrie (comme l’antipsychiatrie de Laing ou Basaglia). Ces courants avaient déjà une idée forte : redonner aux patients une place d’acteurs dans la cité.
Leur outil principal ? Le collectif. Clubs thérapeutiques hier, GEM aujourd’hui.
Et ce n’est pas un hasard si les GEM ont été reconnus par la loi de 2005 comme dispositifs légitimes de participation : ils portent en eux une vision du soin fondée sur la citoyenneté, pas sur l’isolement.
L’envie de servir, pas juste d’être aidé
Ce que montre l’enquête de Marielle Valran, c’est que les motivations à rejoindre un GEM sont diverses. Certains y viennent d’abord dans une perspective thérapeutique, un peu perdus sur le rôle réel de la structure. Mais d’autres y viennent pour une raison plus puissante encore : le désir de se rendre utile.
Un membre du GEM lui confie :
« On se rend utile, les personnes nous rendent utiles. »
Cette quête d’utilité n’est pas anodine : elle renverse la logique d’assistance. Elle montre que beaucoup ne cherchent pas à être pris en charge, mais à retrouver une fonction dans le monde.
Et cette implication est parfois si forte qu’elle s’apparente à un véritable travail à plein temps. Certains membres finissent par rejoindre le bureau de l’association, organisent des activités, assurent la continuité du projet. Leur langage, d’ailleurs, est parlant : ils utilisent spontanément le vocabulaire du monde professionnel.
Mais pourquoi cela ne débouche-t-il pas sur un emploi ?
C’est l’un des paradoxes soulignés par l’auteure : bien que l’engagement dans un GEM soit parfois aussi exigeant et structurant qu’un emploi, il n’est que très rarement considéré comme un tremplin vers le travail salarié.
Doit-on s’en plaindre ? Pas forcément.
Certaines personnes trouvent dans cette activité bénévole un équilibre qu’elles n’avaient jamais atteint dans l’emploi classique. L’un des membres du GEM de Marmande en témoigne : il a trouvé, dans cette implication non rémunérée, un épanouissement bien plus fort que dans sa carrière passée.
Là encore, la clé semble résider dans deux leviers fondamentaux :
- Le sentiment d’utilité
- La reconnaissance d’une participation pleine et entière
Une dynamique à double sens
Ce que Marielle Valran décrit comme un « double processus transactionnel » est peut-être l’un des apports les plus subtils de son travail. Car dans un GEM :
- l’individu transforme l’association,
- l’association transforme l’individu,
- et ensemble, ils influencent le tissu social.
La participation devient un mouvement vivant, réciproque, dynamique. Elle n’est pas imposée d’en haut, elle émerge de la relation entre pairs, dans l’horizontalité.
Et c’est sans doute pour cela que ce modèle fonctionne : parce qu’il ne parle pas d’inclusion en théorie, mais qu’il la met en œuvre au quotidien, sans faux-semblants.
Vers une synthèse ambitieuse : le modèle CEISP
Ce double levier – participation réelle et sentiment d’utilité – est aussi au cœur d’un autre dispositif innovant : le CEISP (Collectif d’Entraide et d’Insertion Sociale et Professionnelle), inspiré des Clubhouses, qui pousse encore plus loin la logique des GEM en la structurant comme un écosystème de réhabilitation psychosociale, avec une ambition claire : la reconstruction par le faire-ensemble.
C’est peut-être là l’avenir des politiques de santé mentale : non plus soigner contre la société, mais se reconstruire dans la société, avec elle.