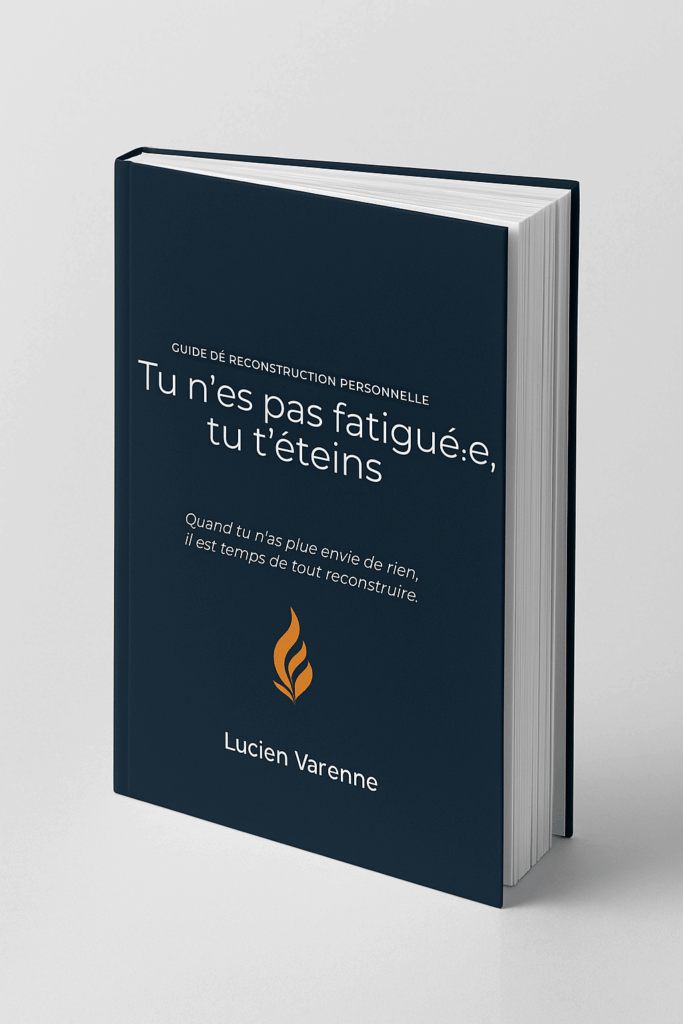Pourquoi certains vivent leur job comme une vocation, et d’autres comme une punition
On parle de plus en plus du sens au travail. On dit qu’il en manque, qu’il faut le retrouver, qu’il est vital. Mais qu’est-ce que le « sens » exactement ? Et pourquoi sa perte peut-elle conduire au mal-être, voire à la souffrance ?
La psychologue Caroline Arnoux-Nicolas, spécialiste de cette question, nous propose un éclairage aussi limpide que profond dans son ouvrage Donner un sens au travail.
Trois sens… du mot sens
Avant même d’entrer dans le vif du sujet, elle nous rappelle un point clé : le mot sens a plusieurs significations.
👉 C’est d’abord ce que l’on perçoit avec les sens,
👉 Ensuite, c’est la direction que l’on prend,
👉 Enfin, c’est la signification que l’on donne.
Appliqué au travail, cela veut dire que donner du sens, c’est à la fois ressentir, s’orienter, et comprendre.
Mais qu’en est-il du mot travail ? Là aussi, la racine est éloquente : travail vient du latin tripalium, un instrument de torture. Rien de très engageant.
Deux visions opposées du travail
Arnoux-Nicolas distingue alors deux visions du travail, presque opposées :
- D’un côté, une activité pénible, contraignante, subie, proche du sens originel du mot.
- De l’autre, une activité créative, intellectuelle, construite, qui relève davantage du mot latin opus – l’œuvre.
Et tout est là : certains vivent leur travail comme un moyen de s’exprimer, de créer, de contribuer. D’autres, au contraire, le vivent comme une charge, une corvée, voire une forme de torture moderne.
Cette divergence n’est pas seulement individuelle. Elle est aussi organisée collectivement, historiquement, idéologiquement.
Le sens : une affaire personnelle… et politique
Le sens du travail ne dépend pas uniquement de l’individu. Il est aussi façonné par la société. Et depuis la révolution industrielle, ce rapport collectif au travail a été profondément transformé.
Karl Marx, philosophe emblématique du XIXe siècle, a joué un rôle central dans cette réflexion. Pour lui, le travail est “l’essence de l’homme”, ce par quoi il se réalise. Mais dans un système où l’ouvrier n’est qu’un rouage de la machine, le fruit de son travail lui est volé, et il devient aliéné : il ne se reconnaît plus dans ce qu’il fait.
« L’ouvrier ne s’affirme pas dans le travail, mais se nie. […] Le travail est extérieur à lui. »
– Karl Marx, cité par Arnoux-Nicolas
Cette idée n’est pas isolée. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, Adam Smith, père du libéralisme économique, observait que la division du travail, si elle augmente la productivité, appauvrit l’esprit :
« Un homme dont la vie se passe à répéter les mêmes gestes ne développe ni son intelligence, ni son imagination. »
Autrement dit : le travail répétitif, sans réflexion, sans créativité, éteint l’humain. Il devient un automate.
Perte de sens, perte de soi
Quand on relie ces constats anciens à la réalité d’aujourd’hui — open space, protocoles, tâches fragmentées, ubérisation — on comprend mieux pourquoi tant de gens souffrent au travail.
Le travail, dans son idéal, devrait être une œuvre. Un espace de contribution, d’expression, de transformation.
Mais dans bien des cas, il est devenu un espace de soumission, d’absurdité, de vide.
La perte de sens n’est donc pas seulement un problème moral. C’est un problème existentiel.
Redonner du sens : une nécessité vitale
Alors, comment sortir de cette ambivalence entre torture et œuvre ? Entre tripalium et opus ?
Cela commence par reconnaître que le sens n’est ni un luxe, ni une utopie. C’est un besoin fondamental.
Un travail qui a du sens, c’est un travail dans lequel :
✔️ Je me reconnais.
✔️ Je vois l’impact de mes actions.
✔️ J’ai une certaine autonomie.
✔️ Je peux apprendre, évoluer, contribuer.
Ce n’est pas forcément un travail parfait. Mais c’est un travail humain.