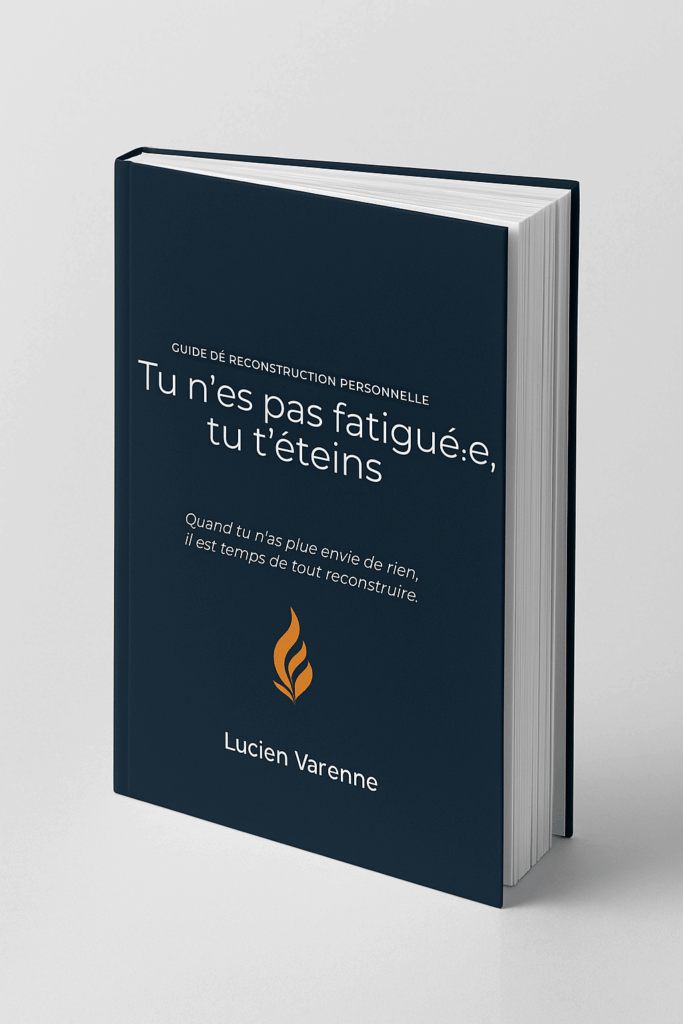Pourquoi une vocation aussi noble peut aujourd’hui devenir un chemin de souffrance
Soigner, c’est l’un des plus beaux métiers du monde. Un métier de lien, d’humanité, d’utilité. Pourtant, de plus en plus de professionnels de santé craquent. Épuisés, désabusés, parfois dévastés par un métier qu’ils avaient pourtant choisi avec conviction.
C’est ce paradoxe qu’explorent la philosophe Valérie Gateau et la psychanalyste et professeure Cynthia Fleury dans un article marquant : Pour une clinique philosophique du burn-out des professionnels de santé. À travers leur analyse, une question centrale émerge : et si ce n’était pas le métier en soi qui posait problème, mais la façon dont on l’organise aujourd’hui ?
La pandémie, révélateur du sens oublié
La crise du Covid-19 a tout bouleversé. Et paradoxalement, elle a ravivé une vérité fondamentale : le soin a du sens.
Gateau et Fleury parlent d’un “retour au sens” du métier pendant la pandémie. Les soignants, malgré la peur et la fatigue, ont retrouvé l’essence même de leur vocation : être là pour les autres.
Mais ce retour au sens n’a été qu’un éclair dans la tempête. Une parenthèse, vite refermée, par une réalité bien plus brutale : celle d’un système devenu toxique.
Un métier humain enfermé dans des logiques inhumaines
Les auteures montrent que les burn-out dans les métiers du soin sont en forte augmentation. Et ce n’est pas une fatalité biologique : ce sont les conditions de travail qui rendent malades.
Car si le travail est en principe bon pour la santé – parce qu’il donne du lien, de la dignité, un rôle social – il peut, dans de mauvaises conditions, détruire tout cela.
Et c’est exactement ce qui se passe quand l’organisation du travail déshumanise l’acte de soigner :
👉 Protocoles rigides,
👉 Codage informatique à outrance,
👉 Gestion par indicateurs,
👉 Performance mesurée au détriment du vécu.
Les soignants ne reconnaissent plus le métier qu’ils ont rêvé d’exercer. Ce qu’ils imaginaient comme un espace d’écoute, de contact, de compassion… se transforme en usine à actes standardisés. La vocation devient désillusion.
Le burn-out, un révélateur systémique
Le burn-out ne dit pas seulement : « je suis fatigué ». Il dit : « ce que je fais n’a plus de sens pour moi ».
Et c’est là que Gateau et Fleury frappent fort. Elles ne s’arrêtent pas à une critique des conditions de travail : elles montrent que notre société entière est structurée par une survalorisation du travail, qui devient un “fait social total”.
Le travail détermine :
- notre niveau de vie,
- notre place dans la société,
- notre identité,
- et même notre estime de soi.
Ne pas travailler, c’est risquer de perdre tout cela à la fois.
Mais dans le même temps, le travail organisé autour de logiques productivistes abîme ceux qui l’exercent. Ce qui donne naissance à une contradiction profonde :
👉 Nous avons besoin du travail pour vivre, mais le travail peut aussi nous détruire.
Quand le sens moral se heurte à la réalité du terrain
L’article évoque aussi une forme plus insidieuse de souffrance : celle de ceux qui doivent participer à des pratiques qu’ils désapprouvent.
Faute de moyens, de temps, ou de marge de manœuvre, certains soignants se voient contraints d’agir contre leur propre éthique professionnelle. Cela n’apparaît pas dans les indicateurs de performance. Mais ça laisse des traces psychiques profondes.
Et ce phénomène ne touche pas que les hôpitaux. Partout, dans tous les secteurs, on dénonce les mêmes causes :
👉 cadence inhumaine,
👉 perte de sens,
👉 perte d’autonomie,
👉 et gestion par les chiffres.
Travailler ou se perdre ?
Si, comme le disait Aristote, “l’homme est un animal social”, alors l’absence de travail pourrait nous condamner à l’isolement. Mais si le travail lui-même nous coupe du lien, du sens et de la dignité, c’est notre humanité qui vacille.
Il ne suffit donc pas de dire que « travailler, c’est bien ». Il faut aussi s’interroger sur la manière dont nous faisons travailler les gens.
Pourquoi certains s’épanouissent malgré tout ?
Face à ce constat sombre, une question demeure : pourquoi certaines personnes continuent-elles à s’épanouir dans leur travail ?
La réponse semble tenir en un mot : alignement.
Quand ce que je fais a du sens pour moi, quand mes valeurs personnelles rencontrent la mission que je remplis, quand je suis reconnu, soutenu et libre d’agir… alors le travail devient un moteur.
Mais quand le sens est absent, que la machine est trop lourde, ou que je dois trahir ce en quoi je crois, le moteur finit par exploser.
Travailler, oui… mais pas à n’importe quelles conditions
Ce que nous dit la philosophie du burn-out, c’est que la souffrance au travail n’est pas une affaire individuelle. Elle est le symptôme d’un système qui a oublié que le travail est d’abord un acte profondément humain.
Et s’il est humain, alors il doit respecter la personne, ses besoins, ses limites… et surtout, son besoin de sens.