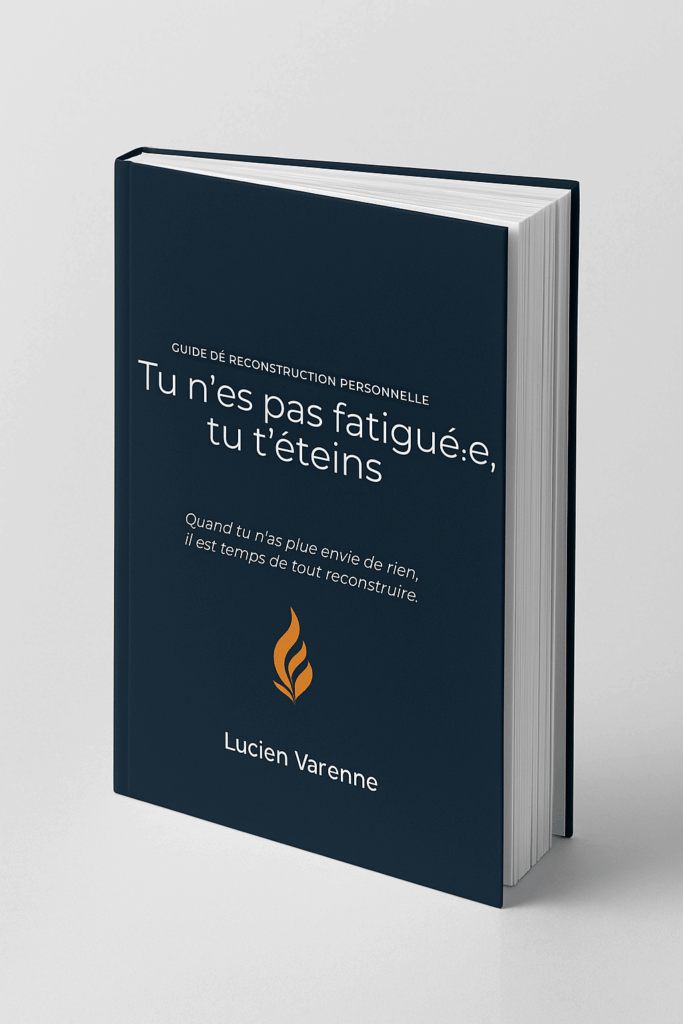En 2013, Graeber écrit un simple article pour un magazine radical. Il y parle des “jobs à la con”. En quelques jours, l’article devient viral. Des millions de personnes se reconnaissent dans cette idée simple : avoir un emploi… qui ne sert à rien.
Des sondages vont rapidement confirmer son intuition :
- En Grande-Bretagne, 37 % des personnes interrogées estiment que leur travail n’apporte rien d’important au monde.
- Aux Pays-Bas, 40 % des travailleurs déclarent que leur job n’a aucune raison valable d’exister.
Le symptôme d’une société malade
Pour Graeber, le problème est moral autant que social.
Des millions de gens passent leur vie à faire semblant d’être utiles, alors qu’ils sentent au fond d’eux que leur travail est vide.
Et cette situation est extrêmement violente psychologiquement. Elle provoque de la honte, de la frustration, de la rage sourde.
Mais au lieu de remettre en question cette absurdité, la société réussit un tour de passe-passe cynique : elle valorise les jobs inutiles bien payés… et méprise les métiers utiles mal rémunérés.
« S’il disparaissait demain, un infirmier, un éboueur ou un mécanicien manquerait cruellement.
En revanche, on ne pleurerait pas la disparition soudaine de tous les lobbyistes ou consultants en relations publiques. »
— David Graeber, Bullshit Jobs
Job à la con ou job de merde ?
Graeber distingue deux catégories :
- Les jobs à la con : bien payés, confortables… mais sans utilité réelle.
- Les jobs de merde : mal payés, pénibles… mais essentiels à la société.
Le point commun entre les deux ? La souffrance.
Mais la différence majeure, c’est que ceux qui ont un “job de merde” savent qu’ils sont utiles. Et ça change tout.
Le fil rouge : l’utilité perçue = le sens vécu
Que ce soit chez Stiegler ou Graeber, le sentiment d’utilité est la clé du sens.
On ne souffre pas tant parce qu’on travaille dur… mais parce qu’on ne comprend plus pourquoi on travaille.
Le pire, disait Dostoïevski, ce n’est pas le travail pénible.
C’est le travail inutile, absurde, sans but.
« « Il m’est venu un jour à l’idée que si l’on voulait réduire un homme à néant, le punir atrocement, l’écraser tellement que le meurtrier le plus endurci tremblerait lui-même devant ce châtiment et s’effrayerait d’avance, il suffirait de donner à son travail un caractère de complète inutilité, voire même d’absurdité »
Le paradoxe français
On l’a vu dans les chapitres précédents : en France, le travail est très valorisé. Il est source de reconnaissance, de socialité, de développement personnel.
Et pourtant, il devient de plus en plus vide de sens, sous l’effet des réformes managériales et de la logique néolibérale depuis les années 1980.
Ce paradoxe devient insoutenable :
- Les Français veulent s’épanouir par leur travail,
- Mais l’organisation actuelle du travail les prive progressivement de cette possibilité.
L’emploi prend le dessus sur le travail.
Le contrôle remplace la confiance.
L’absurde étouffe l’utile.
Et le salarié devient un employé sans vocation.
La seule issue : retrouver du sens
Revenir à un travail qui transforme.
Un travail qui fait appel à l’intelligence, à la créativité, au lien humain.
Un travail où l’on voit ce qu’on change, ce qu’on crée, ce qu’on sert.
Stiegler parlait de néguentropie : un travail qui crée du vivant.
Graeber parlait d’utilité sociale : un travail qui compte pour les autres.
C’est peut-être cela, au fond, le sens du travail :
👉 Une activité dans laquelle je me reconnais,
👉 Qui a un impact,
👉 Et qui fait du bien autour de moi.