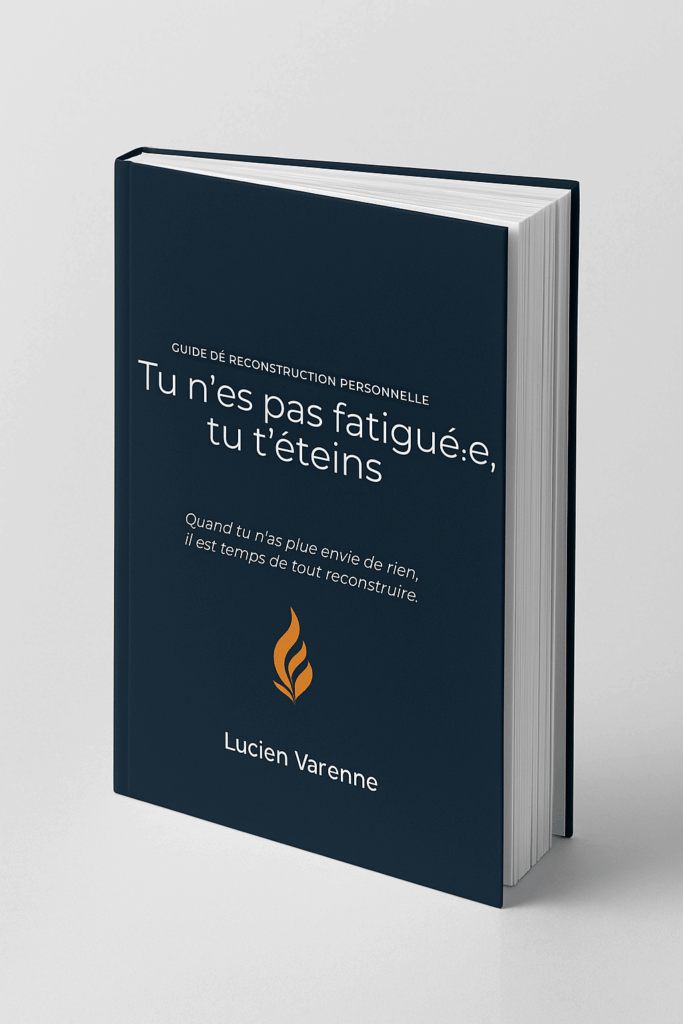Quand l’engagement devient épuisement, et que l’utilité laisse place à l’absurde
On nous a toujours dit que le travail, c’était bon pour la santé. Structurant, gratifiant, porteur de sens. Et pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent pour dire l’inverse : le travail rend malade. Non pas parce qu’il est trop dur physiquement, mais parce qu’il abîme psychologiquement.
C’est ce que dénonce Alain Supiot, juriste et professeur émérite au Collège de France, dans une leçon magistrale intitulée Le travail n’est pas une marchandise. Une phrase simple, presque évidente. Et pourtant, aujourd’hui, tout indique le contraire.
Travailler beaucoup, être évalué partout, n’avoir de valeur nulle part
Dans notre époque connectée, les salariés sont devenus des nœuds dans des réseaux d’informations. On leur demande de traiter des flux toujours plus denses, toujours plus vite. On les évalue en permanence à l’aide d’indicateurs déconnectés du réel, qui ne tiennent plus compte ni de la tâche accomplie, ni de l’effort fourni, ni de la valeur humaine du travail.
Résultat ? Une explosion des troubles psychiques liés au travail. En France, leur nombre aurait été multiplié par sept en cinq ans, entre 2012 et 2017.
Et c’est sans compter sur la précarité moderne : les travailleurs « ubérisés », livrés à eux-mêmes, sans protection sociale, sans perspective de progression, bloqués dans un “en-deçà de l’emploi”, pour reprendre les mots de Supiot. Une zone grise, où l’on travaille sans jamais vraiment être reconnu comme un travailleur.
Réduire le travail à une marchandise : une fiction dangereuse
À la racine de ce désastre, une croyance profondément ancrée dans nos sociétés : le travail est une marchandise comme une autre. On l’achète, on le vend, on le quantifie. Dans ce modèle, l’humain devient “capital humain”, une formule faussement scientifique popularisée par l’économiste Gary Becker, mais que Supiot rappelle être née… dans les registres d’esclavagistes.
Car considérer le travail comme un produit échangeable, c’est nier la dimension vivante, singulière et engagée de toute activité humaine. Le travail mobilise un corps, une intelligence, des compétences, une histoire personnelle. Ce n’est pas une simple prestation ; c’est une expérience humaine.
Et c’est précisément cette expérience que l’économie dominante choisit d’ignorer.
Quand le salaire devient une créance vide de sens
Dans ce modèle néolibéral, le sens du travail est réduit à sa contrepartie financière. Le salarié échange du temps contre de l’argent. Point. Ce qu’il crée, ce qu’il accomplit, ne lui appartient plus. Le produit de son effort est entièrement capté par l’entreprise.
Cette logique marchande, généralisée à l’échelle des États, a fini par évacuer deux questions essentielles :
👉 Pourquoi travailler ?
👉 Pour quoi faire ?
Autrement dit, le contenu et le sens du travail ont disparu des radars.
Retrouver le sens pour retrouver la santé
Mais l’humain ne fonctionne pas comme une machine. Il a besoin de sens, pas seulement de salaire. Il a besoin de se reconnaître dans ce qu’il fait, de se sentir utile, créatif, investi. Supiot le rappelle avec force : les entreprises les plus durables sont celles qui donnent une raison d’être à leurs employés. Ce n’est pas un supplément d’âme : c’est une condition de réussite.
Et si une œuvre est réussie, c’est parce que ceux qui y participent comprennent ce qu’ils construisent, et pourquoi ils le font.
Y a-t-il encore des îlots de résistance ?
Il existe encore quelques modèles qui échappent à cette logique de rentabilité absolue. C’est le cas — du moins en théorie — de la fonction publique. Un fonctionnaire est censé servir l’intérêt général, pas la maximisation du profit. Chaque poste, chaque tâche, s’inscrit dans une œuvre commune, orientée vers le bien public.
Dans cette vision, le travail ne se vend pas, il se met au service.
Mais là aussi, les choses changent. Supiot alerte sur le démantèlement progressif du modèle public, via la mise en concurrence avec le privé, y compris sur les postes de direction. La logique de performance et de rentabilité infiltre les institutions qui semblaient les plus protégées, notamment les hôpitaux.
L’hôpital : dernier rempart ou nouveau champ de ruines ?
L’exemple de la fonction publique hospitalière est parlant. Longtemps portée par une éthique du soin et une logique de service, elle a connu un tournant gestionnaire brutal. Rationalisation, objectifs de performance, bureaucratie étouffante…
Résultat : épuisement, démotivation, burn-out.
Le cœur même du métier — prendre soin, être utile, faire du bien — a été englouti sous des couches de procédures et de tableaux Excel. Là où il y avait du sens, il ne reste parfois que du stress.
Travailler, oui. Mais pas à n’importe quel prix.
Le travail peut être une source d’émancipation, de dignité, de construction de soi. Mais il peut aussi devenir une machine à broyer, quand on oublie qu’il s’agit, avant tout, d’une affaire profondément humaine.
Retrouver du sens au travail n’est pas un luxe. C’est une urgence collective, si l’on veut éviter que ce qui est censé nous élever… ne nous détruise.